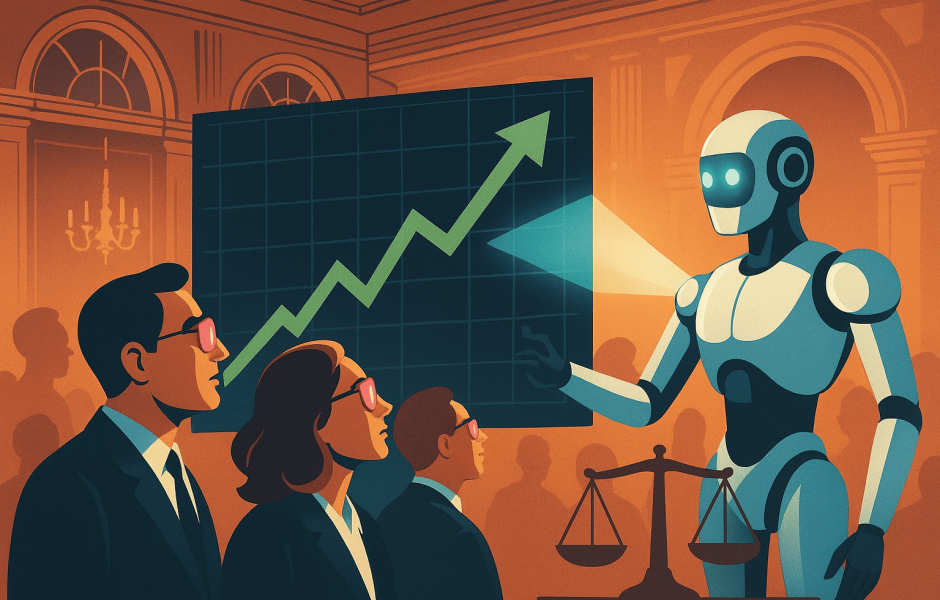
LES LUNETTES ROSES DES INVESTISSEURS Dominique Marchese, 2025-10-02
Mots-clés: Volatilité, Valorisation, IA, Optimisme.
Version PDF
Le mois de septembre, propice au retour de la volatilité, a toujours été craint par les investisseurs. Celui qui vient de s’achever a dérogé à la règle : les indices boursiers ont battu de nouveaux records, tirés par Wall Street, pour tutoyer des niveaux de valorisation historiquement élevés. Face au ralentissement du marché de l’emploi, la banque centrale américaine (Fed) a repris son cycle de baisse des taux directeurs. Les investisseurs évoquent le scénario « Goldilocks » (Boucle d’or) pour décrire la toile de fond favorable aux actifs financiers : la baisse des taux d’intérêt, le ralentissement ordonné de l’économie américaine (faible probabilité de récession) et la croissance des profits portée par l’intelligence artificielle (IA). Cerise sur le gâteau : la crise de 2022 est un lointain souvenir : les prix énergétiques sont orientés à la baisse (offre de pétrole excédentaire, abondance de gaz naturel, décrue des prix de gros de l’électricité en Europe), contribuant à la poursuite de la désinflation mondiale.
Les investisseurs ne veulent pas quitter la salle de bal
La petite musique qui se fait entendre dans la communauté des investisseurs est la suivante : « les marchés sont chers, mais personne ne vend, donc pourquoi devrais-je quitter la salle de bal en premier et abandonner le buffet ? » S’agit-il d’un aveuglement collectif, nourri de stratégies d’investissement passives et de fonds indexés qui escamotent les questions de valorisation des actifs financiers ? Les principaux indices boursiers, surtout américains, sont en effet devenus chers (Le principal indice mondial valorisé à plus de 21 fois les résultats attendus en 2025, Wall Street à 25 fois, l’indice majeur des valeurs technologique à plus de 30 fois), voire complaisants, tirés par les leaders technologiques et l’engouement pour l’IA. Les primes de risque paraissent désormais dérisoires en dehors des marchés européens et émergents, ne reflétant plus aucun risque de récession malgré le chaos provoqué par la Maison-Blanche depuis le début de l’année (guerre commerciale, politique migratoire, fermeture récente de plusieurs agences fédérales…), qui a pourtant un impact réel sur la confiance des agents économiques et la croissance de l’activité américaine (ralentissement du marché du travail et de la consommation, attentisme des entreprises en dehors des technologies de l’information…). Pourtant, la situation d’ensemble n’est nullement catastrophique : la croissance économique mondiale reste arrimée à son rythme de croisière autour de 3% par an en volume, - la prévision la plus récente de l’OCDE pour 2026 est de +2,9% (malgré le rythme de croissance américaine divisé par deux depuis 2024). Certes, le plein effet des tarifs douaniers ne s’est pas encore fait réellement sentir sur les échanges mondiaux et le comportement des consommateurs américains (phénomène de surstockage avant la mise en application des mesures annoncées), et quelques signes d’inquiétude bien légitimes portent sur l’emploi aux États-Unis (conséquence logique de l’attrition des flux migratoires sur le nombre des créations de nouveaux postes). Le degré élevé de corrélation entre les dépenses de consommation des ménages américains et l’effet richesse induit par la performance remarquable des actifs financiers (indices boursiers à des niveaux records, engouement pour les cryptoactifs…) est un facteur supplémentaire qui fragilise les perspectives de consommation en cas de correction brutale des marchés, alors que le taux d’épargne des ménages est très faible. En outre, l’intense pression politique de la Maison-Blanche sur la Fed (tentative de prise de contrôle du comité des gouverneurs, volonté déterminée de monétisation de la dette fédérale), qui doit nous rappeler le lien historique bien établi entre l’indépendance des banques centrales à l’égard du pouvoir politique et la stabilité monétaire, n’est a priori pas de nature à rassurer les investisseurs en dollars. Cependant, les marchés préfèrent de loin continuer à mettre de côté les éléments inquiétants, en témoigne la volatilité très basse et pour le moins interpellante des prix des actifs financiers, assez peu en ligne avec le degré d’incertitude élevé. Notons cependant l’un des rares signaux à dénoter quelques appréhensions : l’or qui bat de nouveaux records…
Les primes de risque (en dehors des indices boursiers européens et émergents) et la volatilité sont donc proches des points bas historiques, y compris dans le segment des obligations d’entreprise (écarts de taux avec les obligations souveraines). Faut-il s’en inquiéter ? Cette question est légitime, car nous devons bien reconnaître que le discours ambiant qui consiste à rationaliser cette période d’excès se résume à cette phrase souvent entendue dans les périodes qui ont précédé les crises boursières : « cette fois, c’est différent » ! Mais si la valorisation de marché des actifs financiers est déterminante pour en estimer le retour sur investissement à long terme, elle n’est en rien, à elle seule, explicative de la performance à court terme. Autrement dit, les marchés sont chèrement valorisés aujourd’hui, mais peuvent parfaitement le rester dans le proche avenir sans aucun catalyseur remettant en cause le scénario de base des investisseurs.
Avant d’aborder les sujets à suivre de près, nous voulons évoquer une récente étude de McKinsey sur les profits globaux des entreprises qui, en moyenne sur la période 2020-2024 et ajustés de l’inflation, sont supérieurs de 50% au niveau moyen de 2005-2009. De plus, la part de ces profits dans le produit intérieur brut (PIB) mondial est restée stable entre ces deux périodes à 1,1%, après un passage à vide à 0,5% juste avant la pandémie. Autrement dit, il n’est pas exact d’affirmer que les marchés boursiers sont complètement déconnectés de la réalité. Sur les vingt dernières années, les profits ont accompagné la croissance mondiale.
Les deux conditions pour justifier la hausse des marchés
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a qualifié le marché des actions comme étant « fairly highly valued », c’est-à-dire plutôt chèrement valorisé. Cette déclaration du 23 septembre n’a pas eu beaucoup d’effet sur l’humeur enjouée des investisseurs. Nous rappelons au passage que l’évocation de l’exubérance irrationnelle des marchés en 1996 par Alan Greenspan, président de la Fed de 1987 à 2006, n’avait pas eu beaucoup d’effet non plus, puisque les indices boursiers avaient poursuivi sur leur lancée durant quatre ans avant l’éclatement de la bulle internet qui est restée dans la mémoire collective comme le parangon des délires des investisseurs prisonniers des effets de mode. Sommes-nous dans le même cas de figure ?
Les deux sujets importants se résument en définitive à l’IA et aux conséquences de la politique menée par la Maison-Blanche. En ce qui concerne le pari de Donald Trump, l’économie américaine résiste plutôt bien jusqu’à présent, même si l’activité devrait manquer de vigueur au second semestre. De fait, la politique migratoire et les gesticulations commerciales ont clairement affaibli le profil de croissance de l’économie américaine à court terme, avec en prime quelques pressions inflationnistes (tarifs douaniers) jugées temporaires (Fed). De plus, il semble que le déficit budgétaire fédéral est bien parti pour rester durablement élevé, autour de 6 à 7% du PIB (d’où les pressions de la Maison-Blanche pour prendre le contrôle de la banque centrale) ; les recettes espérées et très hypothétiques provenant du relèvement des droits de douane (quelques centaines de milliards de dollars tout au plus) devraient rester très inférieures au déficit public et même au seul service de la dette qui devrait dépasser le trillion de dollars ! En réalité, Donald Trump semble vouloir tout miser sur la réindustrialisation du pays et sur le cycle d’investissement engendré par les baisses d’impôts (notamment les nouvelles règles d’amortissement des investissements des entreprises prévues dans la loi budgétaire One Big Beautiful Bill Act, et qui pourraient se traduire par un taux effectif d’imposition très inférieur au taux légal de 21%), la dérégulation (services financiers, énergie…), les incitations à l’égard des entreprises étrangères pour localiser leurs unités de production aux États-Unis (au besoin par les menaces sur les tarifs, par exemple dans le secteur pharmaceutique et les semiconducteurs), sans oublier quelques programmes de soutien gouvernementaux (pour environ 650 milliards de dollars). Pour le moment, les dépenses des investissements sont surtout portées par l’IA, mais l’objectif de la Maison-Blanche est bien de soutenir un cycle plus étendu d’investissement. Les projets de relocalisation industrielle dépassent déjà 200 milliards de dollars ; ce n’est sans doute qu’un début. Le pari de Donald Trump est évidemment osé et, reconnaissons-le, très largement contesté par la communauté des économistes attachée aux vertus du multilatéralisme et du libre-échange. Seul l’avenir nous dira si la révolution macroéconomique trumpiste est une chimère ou l’expression d’une intuition géniale, et si l’exceptionnalisme américain est définitivement mis à mal. Néanmoins, en guise d’illustration des effets parfois favorables de la « stratégie du pistolet sur la tempe », nous voulons mentionner le récent accord entre Pfizer et l’Administration Trump sur les prix des médicaments pratiqués aux États-Unis et qui sont très supérieurs en moyenne à ceux en vigueur dans les principaux pays développés (résultat d’une organisation de marché très complexe). L’accord serait notamment bénéfique pour le programme fédéral Medicaid (assurance santé pour les ménages à faibles revenus), en contrepartie d’un engagement pris par les pouvoirs publics d’une accélération des procédures d’homologation des futures nouvelles molécules et d’autorisation des nouvelles unités de production pharmaceutique sur le territoire américain. Pour ses futurs nouveaux médicaments, Pfizer s’engagerait à fixer des prix en ligne avec ceux pratiqués dans les principaux pays développés, une petite révolution aux États-Unis. Donald Trump pourrait-il réussir là où Barack Obama a complètement échoué, en rendant accessible la santé au plus grand nombre à prix beaucoup plus abordables (cf. par exemple son initiative direct-to-consumer) ? C’est trop tôt pour l’affirmer dans la mesure où la Maison-Blanche a la main sur les programmes fédéraux et non pas sur le secteur privé, mais il s’agit bien d’une avancée à saluer.
Qu’en est-il de l’IA ? Le sujet nous parait plus sérieux pour les marchés financiers car il a largement alimenté en carburant les indices boursiers depuis deux ans. En effet, les investisseurs émettent aujourd’hui quelques réserves sur les risques de bulle d’investissement dans les infrastructures nécessaires au déploiement à grande échelle de cette technologie (plus de 400 milliards de dollars attendus en 2026 pour les grands hyperscalers contre moins de 100 milliards de dollars par an avant pandémie). Les annonces récentes d’OpenAI (le développeur de ChatGPT), d’Oracle (hyperscaler) et de Nvidia (puces dédiées à l’IA) ont d’ailleurs alimenté les débats sur la circularité des investissements dans le secteur (investissements du leader des semiconducteurs Nvidia chez un client, à savoir OpenAI, qui lui achète en retour les puces GPU dédiées à l’IA), rappelant les pratiques controversées de la bulle internet. La question du retour sur investissement dans l’IA (monétisation) est évidemment cruciale, mais elle ne recevra aucune réponse à très court terme. Les programmes d’investissement qui augmentent considérablement l’intensité capitalistique du secteur des technologies de l’information - une tendance lourde qui a démarré avec le développement du cloud - vont se déployer sur plusieurs années. Le sujet qui nous semble en réalité bien plus essentiel est celui de l’apport de l’IA à la productivité globale, autrement dit à la création de valeur pour les entreprises qui adoptent l’IA. Sur ce sujet, nous sommes plutôt emballés par les projets qui se multiplient, notamment dans le segment de l’IA agentique. A l’origine, l’engouement général pour l’IA générative et les grands modèles de langage reposait essentiellement sur la révolution technologique que constitue l’interface homme-machine, les êtres humains ayant désormais la possibilité de communiquer dans leur propre langage avec des machines, des robots, des ordinateurs sans devoir nécessairement maîtriser la technicité des langages de programmation (amélioration de l’interactivité). Mais c’est surtout sur l’accélération de la digitalisation de l’économie et de l’automatisation des tâches par la diffusion de l’IA dans l’économie que reposent les immenses espoirs de gains de productivité, et donc d’amélioration de la croissance économique potentielle et de hausse des marges des entreprises. C’est précisément le message que délivrent aujourd’hui les marchés financiers. De ce point de vue, investir aujourd’hui sur les marchés d’actions consiste nécessairement à adopter une vue à long terme et à parier sur une dynamique favorable des bénéfices des entreprises qui reste le facteur déterminant de la performance des indices boursiers. Cette stratégie ne nous paraît pas être l’expression d’une exubérance irrationnelle.
Conclusion
Les marchés financiers semblent valorisés comme si toutes les incertitudes avaient disparu ; la technologie dopée à l’IA reste un puissant carburant pour les indices boursiers. Les investisseurs ne sont pas aveugles aux enjeux de court terme (fin du multilatéralisme, tensions géopolitiques, faiblesses conjoncturelles…), mais ont décidé de porter leur attention sur le long terme et d’intégrer dans leurs réflexions les formidables innovations technologiques qui soutiendront la trajectoire des profits des entreprises dans les prochaines années. La cherté des indices milite néanmoins pour davantage de diversification, de travail sur la valorisation des actifs financiers, et pour un arbitrage en faveur des stratégies d’allocation plus actives et flexibles. En outre, la faiblesse des volatilités offre des possibilités de couverture à prix réduits.
